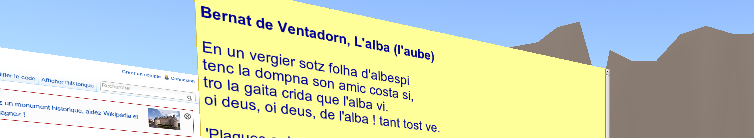Lors de la visite de Rachel Hausfater, auteur de Yankov faisant partie de la sélection du Prix des Incorruptibles, les élèves de la 2e1 ont participé à l’amorce d’un atelier d’écriture. Se documenter et (ou) inventer pour écrire une fiction ? A partir d’un fait réel (actualité, histoire), rédiger quelques lignes personnelles : telle était la consigne. Des idées originales ont émergé lors de cette rencontre, les élèves ont poursuivi en cours de français. Nous publions ici des textes des élèves volontaires.
COLUMBINE
CHAPITRE 1
L’INCIDENT INITIAL
L’ASSASSINAT DE DANIEL PAR LE LACHE DYLAN KLEBOLD
« Tu sais très bien que ma mère ne voudra pas, Sean.
– Mais si elle voudra. Dis-lui juste qu’on ne rentrera pas tard ! »
Ça fait maintenant une heure que Sean essaie de me convaincre de venir chez Rachel pour la soirée de vendredi. Nous sommes tous les trois, avec Lance, assis sur l’escalier ouest. Nous avons encore le temps, les cours reprennent seulement à 14h00, ça nous laisse trois heures devant nous.
« Sean a raison, reprend Lance, c’est juste que tu ne sais pas t’y prendre avec ta mère.
– Je vous dis qu’elle ne voudra pas ! C’est quand même ma mère, je la connais non ? Psychorigide et ultra-protectrice… elle est tellement pénible, c’est incroyable.
– Mais il y aura tout le monde chez Rachel ! reprend Sean. Tu le regretteras si tu ne viens pas. En plus, on sait tous que tu l’aimes bien Rachel. »
Je ne réponds pas. Non pas parce que je n’ai pas entendu mais parce que je préfère la regarder. Elle est assise dans l’herbe un peu plus loin, elle déjeune avec Richard.
« Regarde-le, dit Sean à Lance, une seule femme dans l’herbe et le mâle ne répond plus. Il est vraiment temps que tu te lances Daniel. »
Devant Rachel et Richard, j’aperçois Eric Harris et Dylan Klebold qui les regardent. Je les ai toujours trouvés un peu bizarres, mais je ne leur ai jamais parlé pour autant. Je les observe, ils s’avancent lentement vers le monticule herbeux où déjeune Rachel. J’entends Harris crier : « Allez ! Allez ! ». Et puis brutalement, je vois Klebold sortir une arme. Il tire sur Rachel, il tire sur Richard. Personne ne bouge, personne ne comprend. A quoi venons-nous d’assister ? Je ne bouge plus, je crois même que je ne respire plus. Harris et Klebold repartent, nous ne les voyons plus. Je me lève, je cours vers Rachel. Je crois que Sean me crie quelque chose mais je n’entends pas ce qu’il dit, j’entends seulement les coups de feu qui résonnent un peu plus loin. J’arrive enfin près d’elle. C’est une très bonne amie Rachel, je l’ai toujours trouvé belle, intelligente. Mais là, par terre, elle n’est plus belle. Elle a un trou dans les cheveux, du sang sur le visage et les yeux ouverts qui semblent encore vivants, eux. Je ne sais plus où regarder. Je crois entendre Richard geindre, je ne sais pas trop. Je regarde mes amis. « Daniel, cours ! » me crient-ils. Je me retourne et je vois Harris, enlevant son manteau et sortant une arme. Je ne réfléchis pas, j’abandonne ma belle Rachel et un Richard agonisant, et je cours vers l’escalier que j’ai quitté. Et je tombe. Je n’ai pas trébuché mais je ne peux plus avancer. Ma jambe saigne, elle est trouée. Sean et Lance sont par terre eux aussi. Sean et couché sur une flaque pourpre. Lance avance à quatre pattes, le bras ensanglanté. Je rampe, je me traîne vers l’escalier. Je suis presque arrivé à côté de Sean, je peux l’aider, il va se relever. De nous trois, il a toujours été le plus fort Sean. Et puis, telle un rapace qui aurait repéré un rongeur, Klebold arrive juste au-dessus de Lance, et lui tire une balle dans la tête, à bout portant. Et puis il s’approche de moi. Je ne sens plus ma jambe, mais je peux la voir trembler. Il arrive à ma hauteur. Je suis face au sol, je ne veux pas le voir, j’ai trop peur de le voir. Je sens qu’il me met en joue, pas besoin de me retourner. Alors je ferme les yeux, et je pense à ma mère, psychorigide et ultra-protectrice.
11h21 : Décès de Daniel Rohrbough, tué d’une balle dans le dos.
CHAPITRE 2
LE MASSACRE DE LA BIBLIOTHEQUE
L’ASSASSINAT DE CASSIE PAR LE LACHE ERIC HARRIS
Je ne sais pas quoi faire, les autres non plus d’ailleurs. Il règne une ambiance étrange dans la salle. Certains élèves ont peur, d’autre rigolent. Ils pensent à une blague, mais ils sont peu. Et puis soudain, on entend une explosion, plus forte que les autres détonations. Une des vitres de la bibliothèque est soufflée. L’alarme à incendie se met à sonner, mais personne ne sort. Les élèves croyant à une blague ont maintenant peur, comme tout le monde. Notre professeur monte sur une chaise. « S’il vous plaît calmez- vous ! dit-elle sur un ton des plus effrayé. Mettez-vous sous les tables, les secours vont arriver. ». Une vision terrifiante s’offre à moi : cinquante élèves se précipitant sous les tables de notre bibliothèque, certains en criant. Alors je fais comme tout le monde et je trouve un coin de table sous lequel me mettre à l’abri. Un brouhaha d’angoisse s’élève dans la salle. Et nous attendons, alors que des détonations se font encore entendre au loin, mais pas si loin que ça. Des cris retentissent, ils semblent de plus en plus proches. Et là, on entend les portes de la bibliothèque s’ouvrir, et j’aperçois depuis ma cachette deux personnes s’avançant lentement vers nous. Je les entends crier : « Debout ! Levez-vous ! ». Je suis tétanisée, je viens de comprendre que ce sont elles qui tirent depuis tout à l’heure. « Tous ceux qui portent des chapeaux blancs levez-vous ». Ils veulent les sportifs, il est de coutume qu’ils portent des chapeaux blancs à Columbine. « Allez les sportifs, levez-vous ! C’est pour toutes les emmerdes que vous nous avez fait subir pendant ces quatre dernières années. ». C’est à ce moment que je reconnais Eric, un élève discret que je connais à peine. Sous les tables, personne ne bouge, presque pas un bruit. Et l’horreur commence. Les deux étudiants se penchent, et se mettent à tirer sous les tables. J’entends des hurlements comme jamais je n’en ai entendu, des hurlements à se déchirer les cordes vocales. Je vois des élèves se lever pour fuir et se faire abattre par de violents tirs. Les détonations s’arrêtent, je vois par terre des cadavres et des mares de sang. Je suis pétrifiée. J’entends Eric et l’autre tueur que je ne reconnais pas parler avec certains étudiants avant de les abattre. Je les ai vus n’en épargner qu’un seul, John, un ami d’Eric. Et les tirs reprennent. Mes camarades de classes se font abattre un par un sous les tables alors qu’ils essaient tant bien que mal de se protéger avec les chaises. Je les entends tirer et parler, tuer en discutant : « Peut-être qu’on devrait commencer à en poignarder quelques-uns. Ça pourrait être marrant. ». La légèreté avec laquelle ils parlent m’horrifie. Soudain, comble de l’horreur, mon regard croise celui d’Éric. Il abat d’une balle dans la tête la fille avec laquelle il discutait et s’approche lentement de moi. Il s’assoit sur la table qui fait face à celle sous laquelle je m’abrite. Il me fixe avec un regard noir, un regard qui ne s’oublie pas.
« Cassie, c’est ça ? ». Je n’ai pas le courage de répondre. « Tu veux mourir ? ». Je fonds en larmes :
« Non, je t’en supplie ne me tue pas !
– Pourquoi ? Tu penses que tu as le choix ? »
Il se fait interrompre par Dylan – que j’ai depuis reconnu – inspectant chaque recoin de la bibliothèque. « Regarde Eric ! Il y a un nègre juste ici ! ». Ces horribles paroles sont suivies de deux coups de feu. Eric reprend : « Bien joué Dylan, je crois qu’il n’y a plus de nègre dans cette bibliothèque. Quant à toi Cassie, c’est vrai que tu n’as jamais été une salope avec nous, mais tu vas quand même mourir. Même si je ne te tue pas, tu mourras avec cette école de merde, qui brûlera bientôt.
– S’il te plaît Eric, laisse-moi partir. Je t’en supplie !
– Est-ce que tu crois en Dieu, Cassie ? »
Je ne sais pas quoi répondre. Je ne suis pas croyante, mais il risque de tirer si je le contrarie.
« Oui. ».
11h39 : Décès de Cassie Bernall, tuée d’une balle dans la tête.
Émilien
Alors voilà ! Chaque soir, avant de me coucher, les souvenirs me reviennent. Je me souviens de cette année 43 où je fus arraché de ta grand-mère, de ton papa, de ma famille, de mes amis et balancé dans un wagon avec comme destination l’enfer…
Le 6 février 43 fut mon premier jour au camp et le 27 janvier 45 mon dernier. Entre temps, 721 jours de vide, ou presque, comme si ma vie s’était arrêtée. De toute façon, la vie ne peut pas continuer car dépourvu de tous, je n’étais plus rien ! Je n’étais plus que 172 431 ; et ce simple numéro matricule sur mon bras n’avait rien à raconter, ne parlait pas… A ma libération par l’Armée Rouge et mon retour près des miens, j’étais tétanisé, assommé, brisé, incapable de rien. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je ne parlais plus. Je luttais c’est tout ! Mes nuits étaient justes écrasées sous les souvenirs, et non, pas par des cauchemars ; parce que je savais bien que les cauchemars, eux, n’existent pas en vrai. Je repensais inlassablement à mes camarades, mes compagnons de l’horreur, hanté par 1 million de mes frères tués. Et aujourd’hui, 61 ans après notre libération, 172 431 et moi, nous essayons de nous reconstruire sans jamais sombrer dans l’oubli ! Veiller toujours, pour que plus jamais ça ne se reproduise un jour…..
Elsa
 Mon mari m’avait invitée au théâtre pour fêter la venue du petit être qui poussait peu à peu dans mon ventre depuis maintenant quelques semaines. Nous étions en train d’apprécier le spectacle lorsque de grosses détonations retentirent. Le réflexe de tout le monde a été de courir vers les sorties principales ou de se coucher parterre. Dans le mouvement de la foule, je perdis mon mari de vue. Je compris de suite ce qu’il se passait ; c’était très certainement un attentat. Je m’arrêtais un moment, le temps en suspens, pendant que les autres me bousculaient. Je réfléchis. Je me dirigeais alors vers un escalier et bientôt imitée, cinq autres personnes me suivirent. Mon cœur battait à tout rompre, j’eus l’impression qui celui-ci allait s’arrêter. Une boule se formait au creux de mon ventre lorsque je pensais à mon mari. Au bout de ces escaliers se trouvait une unique porte. C’était notre seule sortie si l’on voulait survivre. Je l’ouvris en première et découvris horrifiée qu’il s’agissait de toilettes. J’espérais qu’il y aurait au moins une sortie. Nous rentrâmes dans la petite pièce. Deux hommes tenaient la porte. Nous entendions les coups de feu, ôtant au passage la vie d’une dizaine de personne et laissant nos cœurs brisés. Tout mon corps tremblait et je transpirais à grosses gouttes. Je me dis que bientôt notre heure allait sonner. Soudain, une lueur d’espoir apparue. Je vis dans un coin du plafond, une petite trappe qui devait mener au toit. L’un des deux hommes monta en poussant la trappe poussiéreuse et aida les autres personnes à monter. J’étais la dernière. On m’aida à monter et l’homme referma la trappe. Nous étions alors plonger dans l’obscurité et le silence. Tout le monde s’allongea pour faire le moins de bruit possible. Nous restions ainsi pendant ce qui m’a semblé une éternité. C’était de la véritable torture. Personne ne parlait. Seuls les coups de fusils brisaient le silence insoutenable. Plus bas, ce fut le chaos, nous entendions des gens hurler, d’autres pleurer. Au bout de quelques minutes, une femme allongée près de moi, se mit à sangloter. Je m’approchai d’elle en silence et je la serrai dans mes bras. Pas une seule fois mon cœur n’avait cessé de battre la chamade, mais je tenus le coup. Au bout de cinq heures d’interminable attente, les secours nous trouvèrent. C’était enfin fini. On m’emmena à l’hôpital pour le reste de la nuit. Ma santé ne m’importait pas, je voulais seulement des nouvelles de mon mari. Toute la matinée passa sans même que je ne réagisse à ce qu’il m’était arrivé. J’avais été à deux doigts de mourir. Seulement un peu plus tard, un homme, sans doute un médecin, entra dans ma chambre. Sans le savoir, lorsqu’il été entré dans cette chambre, il avait détruit ma vie. D’un air grave, il m’annonça la mort de mon bébé, ainsi que celle de mon mari.
Mon mari m’avait invitée au théâtre pour fêter la venue du petit être qui poussait peu à peu dans mon ventre depuis maintenant quelques semaines. Nous étions en train d’apprécier le spectacle lorsque de grosses détonations retentirent. Le réflexe de tout le monde a été de courir vers les sorties principales ou de se coucher parterre. Dans le mouvement de la foule, je perdis mon mari de vue. Je compris de suite ce qu’il se passait ; c’était très certainement un attentat. Je m’arrêtais un moment, le temps en suspens, pendant que les autres me bousculaient. Je réfléchis. Je me dirigeais alors vers un escalier et bientôt imitée, cinq autres personnes me suivirent. Mon cœur battait à tout rompre, j’eus l’impression qui celui-ci allait s’arrêter. Une boule se formait au creux de mon ventre lorsque je pensais à mon mari. Au bout de ces escaliers se trouvait une unique porte. C’était notre seule sortie si l’on voulait survivre. Je l’ouvris en première et découvris horrifiée qu’il s’agissait de toilettes. J’espérais qu’il y aurait au moins une sortie. Nous rentrâmes dans la petite pièce. Deux hommes tenaient la porte. Nous entendions les coups de feu, ôtant au passage la vie d’une dizaine de personne et laissant nos cœurs brisés. Tout mon corps tremblait et je transpirais à grosses gouttes. Je me dis que bientôt notre heure allait sonner. Soudain, une lueur d’espoir apparue. Je vis dans un coin du plafond, une petite trappe qui devait mener au toit. L’un des deux hommes monta en poussant la trappe poussiéreuse et aida les autres personnes à monter. J’étais la dernière. On m’aida à monter et l’homme referma la trappe. Nous étions alors plonger dans l’obscurité et le silence. Tout le monde s’allongea pour faire le moins de bruit possible. Nous restions ainsi pendant ce qui m’a semblé une éternité. C’était de la véritable torture. Personne ne parlait. Seuls les coups de fusils brisaient le silence insoutenable. Plus bas, ce fut le chaos, nous entendions des gens hurler, d’autres pleurer. Au bout de quelques minutes, une femme allongée près de moi, se mit à sangloter. Je m’approchai d’elle en silence et je la serrai dans mes bras. Pas une seule fois mon cœur n’avait cessé de battre la chamade, mais je tenus le coup. Au bout de cinq heures d’interminable attente, les secours nous trouvèrent. C’était enfin fini. On m’emmena à l’hôpital pour le reste de la nuit. Ma santé ne m’importait pas, je voulais seulement des nouvelles de mon mari. Toute la matinée passa sans même que je ne réagisse à ce qu’il m’était arrivé. J’avais été à deux doigts de mourir. Seulement un peu plus tard, un homme, sans doute un médecin, entra dans ma chambre. Sans le savoir, lorsqu’il été entré dans cette chambre, il avait détruit ma vie. D’un air grave, il m’annonça la mort de mon bébé, ainsi que celle de mon mari.
Inès

Hiver nucléaire.
Le monde pleure, le monde crie, le monde est en colère. Tout autour de moi, je ressens l’appel sourd des gens en détresse qui ne semble pas être entendu. La neige a tout recouvert d’un épais manteau blanc. Juste les militaires continuent leur ronde incessante, bravant le vent et le froid avec la boule au ventre. Soudain, plus aucun bruit ne se fait entendre.
Dans les rues, personne, dans la maison, personne, dans mon assiette, rien. Il n’y a plus que moi et mes rêves, ceux de m’arracher de la mère patrie, cette terre qui m’a élevé. Mais pour aller où ? Certains me parlent des États-Unis, et de son fameux rêve américain. Cela me semble si simple d’y parvenir.
Mon bonheur se trouve à quelques centaines de mètres de moi. Mais un mur nous sépare, un si grand mur. Un doux cliquetis me ramène à la réalité… C’est celui de la chaudière qui s’éteint.
J’ai froid.
Maman vient de me passer de l’argent pour aller chercher le journal. J’aime bien aller chercher le journal car c’est mon père qui le fait. En parlant de mon père, je ne l’ai pas vu aujourd’hui. Je retourne à la maison, ramener le journal à maman, l’heure tourne, je me demande quand mon père va rentrer ?! En plus aujourd’hui c’est un jour spécial ! Maman me demande de venir et là je vois les informations apparaître à la télévision. Il y a eu une attaque terroriste contre les membres de Charlie Hebdo, là ou travaille mon père. Je vois des visages de personnes décédées apparaissant sur l’écran : ce sont des collègues à mon père. Je vois défiler les photos une à une et là celle de mon père apparaît. Je me dis que c’est impossible que mon père soit mort. Je suis tellement triste, je l’aime tellement. En plus, aujourd’hui c’était mon anniversaire.
Maëva
Comme tous les matins, je vais voir s’il n’y a rien dans ma boîte aux lettres. En réalité, j’attends désespérément une lettre de mon mari, mon cher mari, parti de notre maison depuis bien trop longtemps.
Non, bien sûr, il n’y a rien dans la boîte. Ça fait maintenant presque six mois que j’attends de ses nouvelles. Comme tout le monde, nous pensions que cette guerre ne durerait que quelques mois, mais il est parti depuis trois ans.
Je retourne m’asseoir dans le canapé où nous nous blottissions l’hiver. Je relis la dernière lettre qu’il m’a envoyée.
« Ma chère Lise,
Aujourd’hui, je ne suis pas au front. Je profite de ce temps pour t’écrire cette lettre. Tu me manques, la maison me manque. Pendant que je buvais ma soupe froide, hier, et que je voyais mes camarades attendre la leur dans des vêtements boueux, j’espérais que tu ne vivrais jamais ça.
Embrasse tes parents et la voisine Simone.
Ton mari aimant
Dimitri
P.S. Prends soin d’Any, embrasse-la de ma part. »
En effet, quelques jours plus tard, Any a appris le décès de son frère, Nino. Nous avons beaucoup parlé toutes les deux et nous nous sommes rendu compte de l’enfer vécu par nos hommes.
Mais tout cela date de six mois maintenant et je n’ai plus eu aucune nouvelle de Dimitri, il me manque tellement. Je ne veux pas imaginer pourquoi il ne me répond pas.
C’est aujourd’hui, assise dans ce canapé, le regard perdu dans les flemmes de la cheminée, que je décide de rejoindre Dimitri sur le champs de bataille.
Léa

79 après Jésus-Christ, dans une cité de Rome.
-Papa ! La terre tremble, tout tombe à terre. Papa où es-tu ? Je ne vois plus rien, mes yeux sont remplis de poussière.
Je remontai la rue en essayant de me ternir aux vestiges des maisons, luttant contre les secousses et la chaleur qui semblait augmenter. Je levai la tête et vis un ciel gris avec des nuages aussi sombres que l’ébène. Jamais du haut de mes vingt-quatre années, je n’ai vu un ciel semblable.
Je ne compris pas pourquoi toute la population de Pompéi fuyait vers la mer, et j’attendais de peut-être retrouver mon père. La chaleur était de plus en plus intense, des gouttes de chaleur se perlèrent sur mon front, les secousses, elles étaient plus violentes à chaque fois. Était-ce la raison de cet empressement ?
Un homme portant ses enfants me bascula et je perdis connaissance.
Moi, c’est Luna, je viens de Pompéi et mes parents sont des personnages très importants dans la cité, ou plutôt, l’étaient. Ma mère, fille de l’illustre famille des Arcatium était devenue vestale à 8 ans. Jusqu’à sa majorité, elle représentait la sagesse, la beauté et la rigueur. Seulement, à ses 22 ans, Philia, ma mère rencontra Artémis, mon père, blessé à une bataille et ils tombèrent amoureux.
Une autre jeune vestale, les ayant vus s’embrasser, les dénonça. Ma mère fut brûlée alors que je n’avais que 6 mois. Or, personne, mis à part mes parents, ne connaissaient mon existence. Si quelqu’un l’avait su, j’aurais été moi aussi aujourd’hui en cendres.
En mémoire de ma mère, mon père m’appela Luna : celle qu’on ose regarder tant elle est brillante et majestueuse, disait mon papa.
Mon père ? C’est la seule personne au monde que je connais car en dehors de ma cabane à trente-trois kilomètres de Pompéi, je ne côtoie que des oiseaux. En effet, je n’ai sans doute pas eu la plus belle des enfances en vivant cachée, mais je ne voulais pas devenir vestale, fonction qui avait tué ma mère. C’était donc en quelque sorte une petite rébellion. Depuis petite, mon père me dit que j’ai un talent d’expression orale, un regard captivant et un optimisme à chaque instant. J’étais sa seule famille, sa seule fille, alors il voyait toujours le meilleur pour moi : c’est-à-dire stratège à Pompéi.
Aujourd’hui, nous sommes le 24 août 79, jour où j’aurais dû faire un discours sur le forum devant des centaines de riches citoyens aux regards hautains et devant des centaines d’esclaves aux memebres épuisés.
Aujourd’hui, nous sommes le 24 août 79, premier jour de l’enfer, l’enfer de cette éruption. C’est ça la vérité.
Aujourd’hui, 24 août 79, était en train de se produire l’une des plus grosses catastrophes naturelles qui recouvrira Pompéi en intégralité, des milliers de personnes périront dont peut-être moi ou mon père.
Il est 15h35, mais l’on se croirait la nuit.
Il est 15h35, et désormais, il n’y a plus de différences sociales. Mais c’est bien pire, des hommes bousculent leurs femmes et les laissent à terre, des hommes croisent le regard des nourrissons abandonnés sans les récupérer. Des hommes me piétinent alors que je commence à reprendre mes espoirs. Je cherche toujours parmi la population qui s’agite une tête familière, celle de mon père. Je ne peux pas attendre plus longtemps : je regarde derrière moi et quelques mètres au loin, je vois une sorte de liquide orange se rapprocher très rapidement. Je me mis à courir jusqu’au port. Avant d’y arriver, tout autour des personnes commençaient à s’asphyxier.
Je crus que j’allais mourir de cette façon, mais une personne me pris la main et m’emmena sur une barque. Le jeune home déclina son identité, il n’était autre que Pline le Jeune, neveu de Pline l’Ancien. Il venait d’apprendre la disparition de ce dernier. Je lui confiai ne pas pouvoir m’en aller sans mon père.
Pline et moi avons attendu des dizaines de minutes, en observant ce spectacle funeste. Nous étions éloignés du port mais la fumée devenait plus dense, je commençais à avoir du mal à respirer. Soudain, je vis à travers cette fumée s’apparentant à un épais brouillard, la tête de mon papa. J’ai repris alors espoir.
Malheureusement ce qui m’avait aidé à le distinguer de ce néant, de ce néant de poussières était le magma, juste derrière lui.
La dernière image que je me rappelle de lui était son visage souriant et ses gestes d’adieu, après qu’il fut tué par le grand assassin, le Vésuve.
Mon père fait partie des 2000 morts de l’éruption du Vésuve qui a eu lieu du 24 au 25 août 79.
Les personnes moururent ensevelies sous le magma ou bien asphyxiés par les nuées ardentes.
Pompéi a été retrouvé enseveli en 1600.
Justine